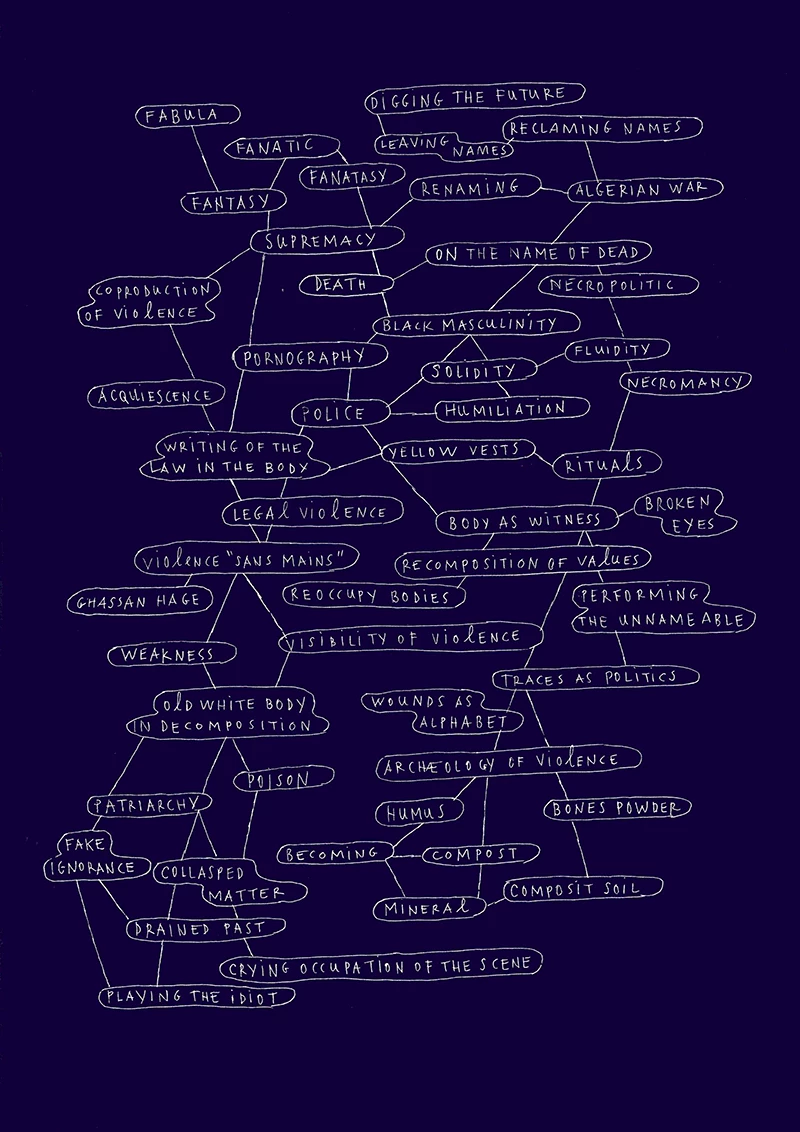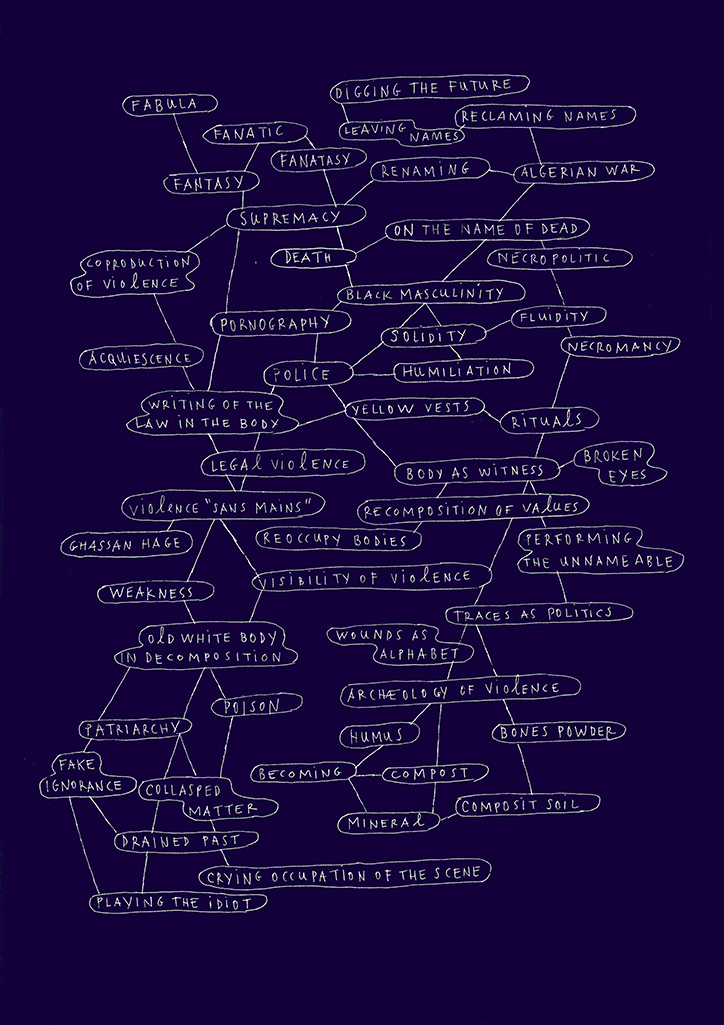
C’est en 2019 que j’ai commencé à imaginer le projet d’un musée du souffle, à l’occasion d’une invitation d’Emmanuelle Chérel, dans le cadre du projet qu’elle développait avec El Hadji Malick Ndiaye autour du site et de la collection du Musée Théodore Monod de Dakar. A vraiment dire, je m’étais jusqu’alors assez peu intéressé à la question des musées, bien que je portais une attention particulière aux mises en récit de l’histoire de la modernité occidentale, aux puissances souvent armées des narrations d’Etat et à la place qu’occupaient les productions culturelles au sein de ces fables politiques. Fables dont le narrateur ne disait jamais vraiment son nom, peuplées d’inébranlables héros et d’évidentes causalités qui faisaient de cette histoire une magnifique continuité, seulement entachée de quelques évènements sans significations1. J’avais pour ma part consacré un certain temps à ces quelques événements, révoltes lointaines, fragiles ruptures, qui n’avaient laissé que des traces discrètes, des grésillements sur la bande son, des taches sur l’image claire du Roman National français. Et s’il y avait matière à exhumer des artefacts abîmés qui pouvaient traduire l’existence de ces parcelles au cœur du récit de la plantation2, j’avais jusqu’à présent consacrer mon énergie à d’autres formes d’archives et d’autres manières de conserver, conscientes ou pas. Celles-ci impliquaient le corps comme site et théâtre d’un retour-détour réparateur de ces voix dispersées qui habitaient comme des ombres ce fameux Roman hexagonal aux vastes tentacules.
Les débats occasionnées par les demandes de restitution des pays africains des objets spoliés par l’Etat français sur le continent puis la publication du rapport rédigé par Felwine Sarr et Bénédicte Savoy ont aiguisé mon intérêt pour le musée. Mais il s’agissait cependant d’un intérêt particulier, spéculatif. Il tentait de penser un « musée du retour » qui devait inventer une hospitalité particulière pour les présences étranges et familières à la fois que sont les objets qui reviennent. Comme toutes les identités diasporiques, les objets qui reviennent font en fait un détour car ils ne peuvent revenir, retourner à leur état « originel ». Puisqu’ils ont profondément changé et que ce changement est irréparable. Ou peut-être que la réparation qui doit alors s’opérer est à considérer dans un espace plus large qui concerne toute la société, tout un ensemble de relations, de formes de vie et de manière de savoir qu’il faut littéralement réinventer, réarticuler entre différents régimes de présence. Comment alors donner ou redonner vie en un lieu comme ce musée du retour à d’autres épistémologies ? Je me suis vite rendu compte qu’au fond ce constat dépassait le cas des musées qui devaient recevoir ces objets spoliés. Cela valait pour la plupart des musées et pouvait donc valoir pour le musée Théodore Monod de Dakar, conçu au Sénégal avec des objets africains qui n’avaient pas voyagé en Europe.
Le musée spéculatif qui me préoccupait n’était pas pensé comme une institution « en dur », mais comme un supplément à des lieux existants, institué par des présences. Il ne se donnait pas comme mission de collectionner – capturer – des artefacts pour les ordonner dans un récit, mais était plutôt pensé comme un tissu lâche, éphémère, non autoritaire de relations entre des formes et des histoires. Un tissu toujours négocié, débattu et donc toujours à refaire qui ne ferait pas de l’oralité un fétiche – ni du corps un spectacle – mais une méthode d’apparition, de présentation / production des objets dans un nouvel état relationnel avec les images fantômes qui les habitent. Ou peut-être même plus précisément un musée qui naîtrait de l’intensification de l’espace entre les objets et les corps qui se présentent à eux, qui viennent leur rendre visite, leur parler, partager un souffle commun. Et c’est à partir de ce tissu d’une archive parlée, respirée, agitée à plusieurs voix qu’il me semblait possible d’inventer un geste de réparation qui serait en soi un lieu, un lieu mouvant, émouvant où les vitrines et les architectures les plus imposantes seraient remplacées par des rumeurs cacophoniques.
Bien que j’aie passé une large part de mon parcours professionnel dans les mondes de l’art et de la culture, j’y suis en fait entré de manière assez accidentelle, par une voie peu académique, par une fenêtre cassée plutôt que par la porte d’un petit ou d’un grand palais, loin du chemin rectiligne et patient d’une carrière à la française. J’ai donc bifurqué pour ma part depuis l’autoroute d’une formation en sciences. Voilà pour le chapitre « études » que j’allais vite remplacer par un furieux empirisme culturel, un Do it by yourself éditorial puis curatorial dans les paysages mouvementés de la banlieue de Paris. Mon intérêt pour l’art allait donc vite s’éloigner de la stricte histoire des formes – et des imaginaires héroïques qui continuent d’en être les compagnons toxiques. J’allais plutôt explorer les possibilités de détourner les outils, les vocabulaires et les moyens de l’art afin de produire des espaces d’autonomie éphémère et faire surgir des récits minoritaires et des fantômes bavards. Des récits que personne ne voulait vraiment entendre, qui n’avaient pas de droit de cité. Des récits couverts de honte et pourtant pleins de puissance dès lors qu’ils échappaient à ce devenir « spectacle » et métaphores. Des récits en acte, secrets. Des récits qui allaient pouvoir grandir à l’abri de la mascarade. L’art, à l’heure néolibérale, était devenu cette machine à tout engloutir, à tout transformer en images – mortes – du vivant. La seule issue était donc d’utiliser à notre tour la puissance d’éblouissement de l’art comme un écran, pour protéger une contrebande, pour protéger un jardin créole fabriqué avec les ressources des institutions mais pas à leur service. Un jardin créole qui échappait à la farce et aux faux semblant dès lors qu’il annonçait secrètement l’existence d’un autre lieu. C’est à cela qu’on reconnaissait ce précieux jardin et qu’il ne pouvait être confondu avec un acte de soumission vaguement mise en scène dans les formes de la résistance, ce qui était devenu l’un des spectacle préféré – cool et sans conséquence – du palais et de son Instagram. Rompre avec le désir de se (re)présenter au palais, mais ne pas renoncer à pratiquer la perruque3. Car il n’était pas tant question de tourner le dos à la puissance de certains objets, de certaines formes, mais plutôt de porter un intérêt encore plus vif à la manière dont ils pouvaient être rejoués, dont ils pouvaient sonner, comme un disque prend une nouvelle texture entre les mains d’un DJ donné, comme un masque est dansé, dans un lieu donné, à un moment donné qui a à avoir avec tout ce qui se passe, s’est passé, va se passer autour, avant et après. Et qui a aussi à voir avec celles et ceux qui sont là, à ce moment-là, dans l’épaisseur moite de la nuit. Manière de dire autrement, par un autre chemin, depuis la perspective d’un jeune homme racisé de la périphérie, ce que j’allais plus tard apprendre des cultural studies et notamment de Stuart Hall : penser l’objet dans un contexte socio-politique changeant qui en intensifie et modifie sans cesse le sens. L’objet et sa permanente reprise, leitmotiv du Musée du souffle qui projette des histoires dont la musique trouble. Il trafique les intensités du lieu qui devient alors un espace possible de poursuite, d’expansion des objets et non une tombe dorée. Un espace pour entendre et voir, un instant, des voix et des images dispersées.
J’imaginais, en somme, entourer de rumeurs le musée des objets, inventer cet autre musée de la présence qui le traverse et l’agite, un musée du souffle composé d’histoires qui manquent. Mais de nouveau, il y a de nombreuses histoires qui manquent et il ne s’agit pas de venir remplacer un héroïsme par un autre comme si c’était de héros dont nous manquions. Nous manquons d’air pour respirer, pour que la parole circule et c’est de cette matière, le souffle, dont nous voudrions prendre soin, dans un musée sans fin et sans mur. Voici donc une fragile idée de muséographie pour réanimer les objets qui sommeillent dans des épistémologies limitées, vidés de leur rêve et du bruit du monde dont ils sont les témoins. A côté des biographies des objets qui nous apprennent l’histoire de leur forme et de leur puissance, leur filiation et leur dérive, qui doivent nous conter à présent la violence qui leur fut faite, j’aimerais contribuer avec d’autres voix à faire entendre l’archive d’un climat, le temps qu’il fait quand l’objet se présente à nous, lui-même chargé d’autres temps, passés et à venir.
J’ai alors commencé tout simplement à collecter des histoires auprès d’ami·es, artistes, poètes, chanteur·euses, activistes – et par capillarité auprès d’autres personnes encore – car le Musée du souffle commence au présent, maintenant. Et il se déploie lentement vers le passé et le futur. J’ai demandé à ces complices de raconter dans leur langue un épisode de lutte, de résistance, un moment de refus et de bifurcation. Des évènements, des jours et des instants-clefs dont l’archive, la conservation et la transmission reposaient sur l’oralité. Et ils m’ont répondu en récits, poèmes, spoke word, chansons et contes, enregistrés en studio ou sur des téléphones portables. Le corps, le souffle et la voix sont les principaux instruments de ce musée. Mais le Musée du souffle n’est pas un écomusée et il s’affranchit de l’idée de témoignage dans laquelle on a trop longtemps enfermé les voix minoritaires. Il s’agit clairement d’un exercice d’imagination – car l’effort d’assemblage d’un monde dispersé nécessite indéniablement les puissances de l’imagination et pas uniquement les ressources de la recherche scientifique. Dans un monde néolibéral à la voracité sans limite pour toutes les formes de savoir, il a cependant fallu imaginer des agencements particuliers à ces archives pour qu’elles ne deviennent pas de nouveaux fétiches à extraire, à capturer et qu’elles conservent de multiples possibilités d’existence, de sens et d’apparition. Chaque nouvelle pièce de ce musée sans fin travaille ainsi ses propres niveaux d’opacité et de transmission située: tous les sons de cette collecte sont en langue originale (une adaptation vers d’autres langues est proposée), convoquent les ressources de la poésie et des stratégies pour dire et dissimuler à la fois, pour coder le sens, fabriquer des échos qui produisent des niveaux de lecture différentiels selon les personnes et les contextes.
Au moment où j’écris ces lignes, j’ai passé la fin de la nuit à correspondre avec mon ami M. qui, depuis la Guadeloupe, commente les interventions du RAID et du GIGN à grand renfort d’images. Il se pose la même question que celle qui m’a poussé à débuter ce Musée du souffle : qui va raconter ce qui se passe vraiment ?
Le Musée du souffle a commencé à Dakar comme une évidence. A l’origine, j’imaginais travailler avec le chanteur et activiste Fou Malade depuis la banlieue de la capitale afin d’inventer une forme de veillée au musée Théodore Monod. Et ainsi venir hanter de voix sénégalaises, populaires et marginales, la périphérie des objets de cette collection. Inventer une conversation avec les fantômes des lieux, ces voix, ces images et ces gestes que les objets et les murs du musée avaient entendu, vu, senti. Ces caresses, ces blessures, ces cris et ces rires. Ce musée oral serait donc à la fois un musée qui parlerait depuis le présent agité du Sénégal, mais qui ferait aussi surgir des apparitions passées et à venir qui habitaient la matière des lieux mais aussi celle des corps. Des corps qui décidaient de se mettre ainsi en mouvement, de donner lieu, d’offrir l’hospitalité à des archives secrètes. La Covid en a décidé autrement, mais nous avons continué à correspondre à distance et Fou Malade a finalement offert deux chansons au Musée, reproduites ci-dessous. Des chansons de lutte, contre la corruption. Elles composent les débuts d’une recherche vers la production d’un lieu expérimental de parole citoyenne à partir de l’idée du concert comme espace d’archive populaire. Car le Musée du souffle est d’abord un exercice empirique qui se développe à partir de veillées, moments de rencontres où, dans l’intimité des présences, les récits se croisent, se tissent et se transforment mutuellement pour produire leur propre lieu sans autres témoins que celles et ceux qui prennent place dans le cercle. Les matériaux bruts que je partage ici ne sont donc que des esquisses qui seront rejouées pour former leurs espaces en se frottant à d’autres matières, histoires et objets.
La veillée est ainsi un motif culturel non spectaculaire, de convivialité, de confiance et de recherche qui m’accompagne depuis plusieurs années. Et c’est donc en toute logique que cette première série d’invitations du Musée du souffle propose également de faire un détour par Haïti afin de donner à entendre les histoires de trois des membres de The Living and The Dead Ensemble4, collectif artistique avec lequel nous avons traversé tant de veillées. Mais ce détour tient aussi au fait qu’il manque certaines voix au cœur de l’image confuse, violente, pleine de terreur et de mépris qui émane aujourd’hui d’Haïti. Et il manque de même des voix dans le vacarme des éloges et des célébrations héroïques de quelques unes des figures politiques, artistiques et littéraires de l’île – celles qui ont su se glisser le plus habillement dans les attentes et les fantasmes des scènes occidentales ou qu’on a fini par contraindre à entrer dans un panthéon mortifère. Les poètes et acteurs Zakh Turin, James Désiris et Rossi Jacques Casimir nous font entendre des voix et des histoires bien différentes, terribles, troublées ou résistantes. Elles habitent les épisodes quotidiens du mauvais drame de Port-au-Prince, mais aussi des utopies agricoles où le Vodou retrouve sa portée politique ancienne. C’est peu de chose et déjà un geste énorme pour la dignité d’un peuple, de résister ou de rire jaune, puisqu’on ne choisit pas la couleur de son rire en espérant qu’elle ne se confonde jamais avec celle du sang. Voici pour notre imaginaire d’un vivant qui résiste dans un souffle commun. Ainsi sonne ces premières intrusions du musée des courants d’air.
-
Je reprends ici à mon compte le titre d’une œuvre de 1974 de Mostafa Derkaoui dans lequel le cinéaste transforme l’espace de son film en une enquête sur le possible devenir d’un cinéma marocain naissant et l’invention d’un vocabulaire particulier qui échappe aux seuls canons occidentaux. Ce film a été porté à ma connaissance par la programmatrice et chercheuse Léa Morin qui a participé à sa restauration réalisée en 2018 par la Filmoteca de Catalunya en partenariat avec l’Observatoire (Casablanca). Dans une conversation récente avec la conservatrice Annabelle Aventurin, Léa Morin dit du film de Derkaoui : « Quand je reçois pour la première fois une photographie de la bobine identifiée par les équipes de Barcelone, tout d’un coup, dans la matérialité même de la pellicule, je réalise (ou j’imagine) qu’y sont inscrites les tensions qui ont traversé le film. L’élan incroyable de ce collectif de cinéastes, artistes et activistes, réuni pour un tournage hors normes dans les rues de Casablanca en 1974, porté par la volonté d’un cinéma nouveau, d’un effacement des disciplines créatives, d’une réflexion sur le pouvoir politique du cinéma. Une expérimentation unique, novatrice et avant-gardiste qui s’est malheureusement finie par une interdiction de diffusion. Et puis l’oubli. Restaurer ce film, le rendre à nouveau visible dans le respect des intentions de son auteur, c’est tenter de restaurer une histoire esthétique et politique manquante. » https://opencitylondon.com/non-fiction/issue-3-space/non-aligned-film-archives/ ↩
-
J’emprunte à l’autrice jamaïcaine Sylvia Wynter cette métaphore littéraire de la parcelle et de la plantation qu’elle a brillamment développée dans son célèbre essai « Novel and History, Plot and Plantation », paru en 1971 dans Savacou, le journal du Mouvement des Artistes de la Caraïbe (Caribbean Artists Movement). ↩
-
Muscles et perruques, Olivier Marboeuf, in Imagi-Nation Nwar (Chimurenga), 2021, republié dans la revue n°4, septembre 2021, Editions Adverse. Dans ce texte, je tente en vingt-et-un courts fragments de revisiter mon parcours d’éditeur au sein des éditions Amok durant les années 90 aux côtés de l’auteur Yvan Alagbé. J’y explore notamment l’art de la perruque où l’outil de production est détourné de ses fonctions premières par l’ouvrier pour produire autre chose. Manière de s’extraire secrètement de la contrainte, des rapports de subordination, de récupérer de son temps, de ses muscles et de son imagination pour soi. Un art de la ruse et du détournement qui reste profondément inscrit dans ma propre vie professionnelle. ↩
-
Pour une présentation de The Living and The Dead Ensemble, voir le site : https://thelivingandthedeadensemble.com/ ↩