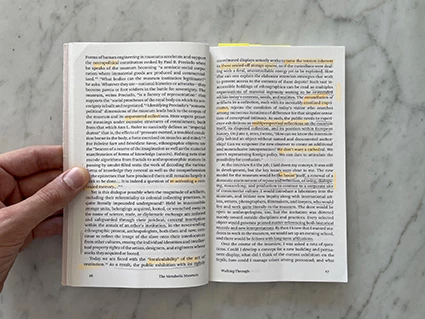Août 2016. Alors jeune diplômé de l’École du Louvre projetant avec détermination de travailler dans les musées, je pars quelques jours à Francfort, moins appâté par la carte postale du cours tranquille du Maine au pied des gratte-ciels ou des maisons à colombage que par l’attrait du Weltkulturen Museum. Un an auparavant, c’est un article de Pauline de Laboulaye dans Artpress au titre prometteur – « Comment décoloniser les musées ethnographiques aujourd’hui ? » –, publié à une époque où les appels à la décolonisation des institutions culturelles étaient moins forts qu’aujourd’hui dans la presse française, qui m’a révélé le projet de transformation profond engagé par Clémentine Deliss. Là-bas, un musée « post-ethnologique » semblait avoir pris racine, décrit avec enthousiasme comme « débarrassé des séquelles de la pensée coloniale », où des dizaines de milliers d’objets et de photographies connaissaient un lent travail de « remédiation » sous les doigts d’artistes en résidence évoluant dans un laboratoire d’un nouveau genre.
Quand j’arrive enfin devant les trois maisons bourgeoises qui composent la silhouette atypique du Weltkulturen Museum, Clémentine Deliss a quitté l’institution depuis plusieurs mois, limogée dans des conditions pour le moins obscures. La visite des expositions alors en cours est loin de susciter l’émerveillement attendu : l’intéressant accrochage « Stories narrate histories » consacré aux récits tus, modestes ou intimes portés par des personnes gravitant autour du Weltkulturen Museum et qui, mis bout à bout, recomposent l’histoire de l’institution, ne suffit pas à compenser la déception d’une seconde exposition convenue autour de dessins réalisés par des enfants réfugiés. L’émotion vient, en fin de compte, moins de la programmation du musée que de son enveloppe, quant à elle encore marquée de l’empreinte de Clémentine Deliss. À déambuler entre ces trois villas du Schaumainkai, dont les façades bourgeoises cachent des espaces lumineux à mille lieux des muséographies écœurantes d’artifices des néo-musées d’ethnographie, je découvre la possibilité d’une scénographie alternative, revendiquant une certaine frugalité. Outre la sobriété de la charte graphique déployée dans le lieu et sur le site internet, j’admire surtout l’ingéniosité du mobilier métallique – élégant et, en apparence, fonctionnel et modulable – qui ponctue la plupart des espaces du musée, des salles d’exposition à la bibliothèque, servant à la fois au travail sur les objets et à leur présentation au public. Pour toute personne connaissant les affres des muséographies luxueuses et figées des architectes stars, inadaptées au quotidien agité des musées et au besoin de renouveler régulièrement et à moindre coût les accrochages, ce système à composer selon les besoins ne pouvait que susciter chez moi un certain émerveillement. Cette visite du Weltkulturen Museum et la découverte de cette expérience inachevée demeureront profondément marquantes.

Façade du bâtiment principal du Weltkulturen Museum © Weltkulturen Museum, Frankfurt. Photo : Wolfgang Günzel.
Novembre 2020. Cela fait un peu plus d’un an que j’exerce en tant que conservateur au Musée de la musique (au sein de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris), chargé de la mal-nommée collection « extra-européenne » ou « musiques du monde », soit un peu plus de 1 200 instruments anciens d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Malgré dix-huit mois de formation à l’Institut national du patrimoine, censés me préparer à la technicité de la gestion de collections et de l’administration culturelle, je ne peux m’empêcher d’éprouver un sentiment de déboussolement face à ces objets silencieux. La mise en évidence croissante des histoires douloureuses que les musées européens ont contribué à écrire par leurs politiques d’acquisition ou d’exposition, tout comme l’affaiblissement du mythe de l’universalité du patrimoine et des dogmes de la conservation occidentale, sur lesquels nombre de conservateur·rice·s ont construit leur identité professionnelle, instillent en moi un malaise redoutable. Le décalage entre les moyens et le temps investis dans la conservation matérielle de ces objets et ceux consacrés à nouer des relations avec des chercheur·e·s, des musicien·ne·s ou des membres des communautés d’origine autour de l’étude et de la valorisation de ces collections m’interroge sur le sens du métier que je commence à exercer. Le fait de ne pas être issu du monde de l’ethnomusicologie me fait d’autant plus fortement sentir la difficulté, voire l’impossibilité, à mettre en mots et en exposition, à partir de travaux académiques plus ou moins datés, une collection dont le moindre instrument ouvre sur une culture musicale ineffable. Mais c’est aussi au Musée de la musique, dont les équipes font face quotidiennement à des arbitrages complexes entre la demande de jeu sur les clavecins ou violons anciens et les contraintes de la conservation préventive, que je mesure ce que la (ré)activation des collections dites « ethnographiques » peut produire et signifier en termes d’enjeux techniques, artistiques et éthiques. Cette confrontation à un patrimoine vibrant, qui place aussi bien les visiteur·se·s que le professionnel·le·s face à l’incongruité de la valorisation statique pratiquée par nos musées, marque aussi un chavirement de ma vision alors trop sage de la conservation en ouvrant de nouvelles perspectives pour réinsuffler du sens aux collections dites « coloniales ».
C’est dans ce moment de doute sur le système muséal que le souvenir du Weltkulturen Museum, quelque peu mis en sommeil depuis ce séjour à Francfort en 2016, renaît par la lecture de The Metabolic Museum de Clémentine Deliss, paru quelques mois plus tôt. Sa forme – un petit livre de 120 pages, à la couverture souple d’un discret rose pâle, et qui se glisse parfaitement dans la poche – autant que son style vif ou son ambition programmatique, lui confèrent un caractère de véritable « Petit Livre rose », capable d’enflammer les esprits de professionnel·le·s de musées désenchanté·e·s. Dans ce texte, l’autrice réunit un matériau déjà formulé par le passé dans plusieurs écrits1, mais qui gagne ici en force et en unité par son inscription dans le récit minutieux de ses cinq années passées à réinvestir une institution qu’elle estime à bout de souffle. Entremêlant plusieurs temporalités, échelles d’observation et formats (emails, fragments poétiques, documents de travail, etc.), les chapitres alternent ainsi plongée dans les lieux du musée, retours sur des épisodes marquants de sa vie de curatrice cosmopolite (comme l’aventure de la revue Métronome entre 1996 et 2007) et critique redoutable des néo-musées d’ethnographie depuis le point de vue de leur architecture, de leur passé colonial refoulé, de leur rapport ambigu à la valeur et à l’authenticité et, surtout, de leur manque cruel d’imagination. Cette déconstruction en règle s’appuie sur l’immersion de Deliss dans les archives, les réserves, les rayonnages de la bibliothèque ou le studio photo du Weltkulturen Museum, lui permettant de décrire de façon quasi haptique le choc sensoriel provoqué par la physicalité d’un musée malade — « The place smelled of a mixture of cowhide, fermented milk, and citric moth repellent » (p. 40).
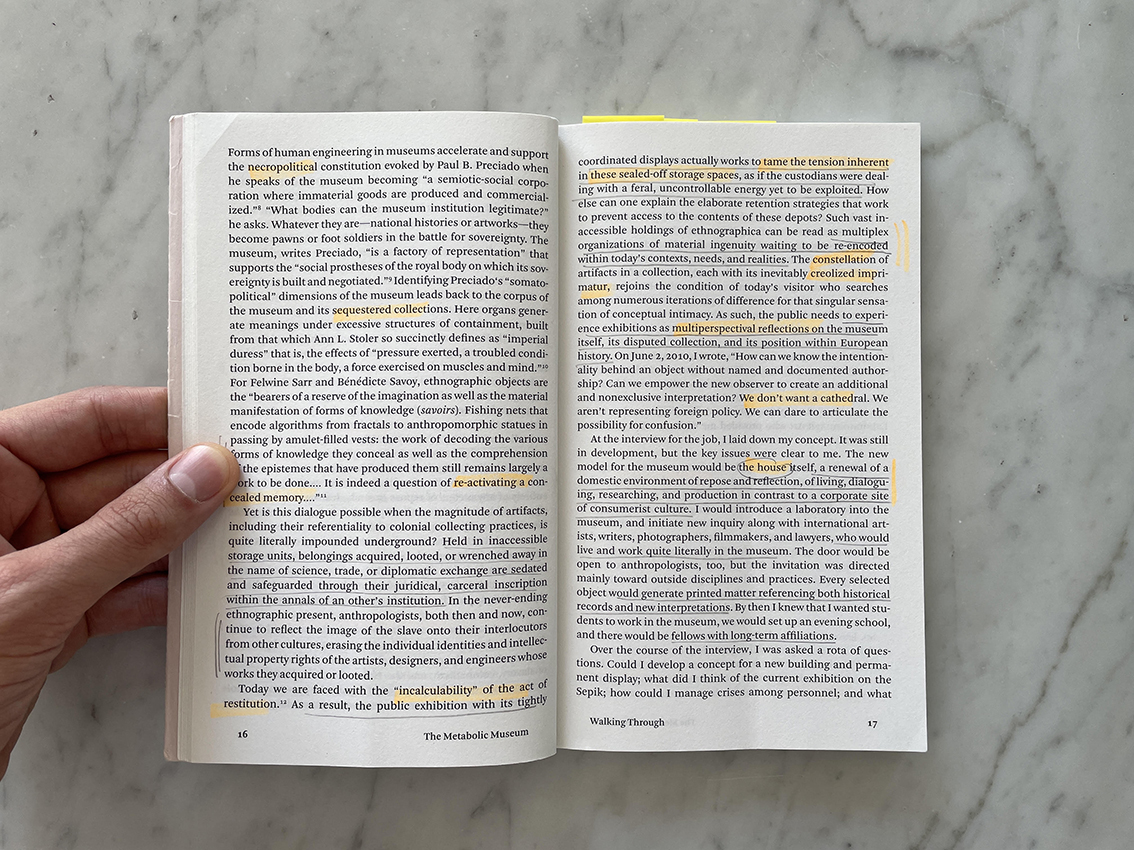
Mon exemplaire de The Metabolic Museum.
Le projet dessiné par Clémentine Deliss résonne tout particulièrement aujourd’hui par sa capacité à dessiner d’autres futurs que la mise en réserve ou la restitution pour les collections dites « ethnographiques » en Europe. Tout en affirmant la nécessité de dévoiler la part d’ombre des musées du Nord et d’engager des actions concrètes en faveur du retour de ces objets dans leurs pays d’origine, Clémentine Deliss déplore avec verve l’hypocrisie des musées européens désireux d’extirper les scories coloniales de leur image de marque sous les auspices de la recherche de provenance, très pratiquée en Allemagne. « Each of these maculate museums seeks the stamp of approval that comes with outing one’s colonial collections by admitting to the blatant absence of solid written and photographic documentation. […] The irony is that the renewed verve goes back to the source in order to recreate missing pieces of information omitted at the time of acquisition. All this is performed under the guide of object biographies and provenance studies. »2 (p. 88) Surtout, elle se veut lucide quant à la lenteur de ce mouvement qui ne doit pas empêcher la réactivation et les usages alternatifs de ces collections en Europe. « Arguments for and against restitution abound, but while these initiatives are addressed, ways of working with these vast collections retained in the vault of museums in Europe need to be worked on. » (p. 88) Dans ce sens, c’est à une transformation profonde des musées qu’elle invite en replaçant leurs vastes collections au cœur de l’expérimentation artistique, poétique et intellectuelle.
Le projet de Clémentine Deliss est d’autant plus convaincant que loin de s’attaquer au seul problème de l’exposition, sur lequel tendent habituellement à se polariser les critiques, celui-ci invite aussi à une reconfiguration globale de son enveloppe qui ne ferait pas l’impasse sur les lieux invisibles aux visiteur·se·s, voire opèrerait un rééquilibrage entre les espaces dédiés à la monstration et ceux consacrés à la recherche depuis les collections. « In Frankfurt, the museum and laboratory were conceived as fifty percent inquiry and fifty percent curation, with equal parts private and public qualifying the organicist character of the exhibition. » (p. 112) Le laboratoire, installé dans l’une des villas qui composent le Weltkulturen Museum, est bien le cœur battant de ce musée métabolique, espace de vie, d’observation et de travail créatif à partir des objets de la collection, dont le fonctionnement découle d’une confiance totale faite aux chercheur·se·s et artistes qui y sont accueilli·e·s en résidence.
The Metabolic Museum enthousiasme, enfin, par sa grande qualité d’écriture et les multiples trouvailles linguistiques de Clémentine Deliss qui, en quelques expressions bien senties, parvient à saisir les failles des musées contemporains et à donner corps au contre-modèle qu’elle propose. « Capitalist aesthetics of the emporium », « monoculture of ethnological museum [resembling] intellectual plantations », « simulacra of voices, ventriloquating on behalf of others », « ghostly reminder of 20th century bourgeois’ drawing rooms », mais aussi « archipelago model of interconnected islands », « intentional inconclusiveness », « museum-university », « school of remediation »… Au même titre que ses écrits précédents, le livre est tramé de ces mots forts ou métaphores qui, par leur récurrence à travers l’ensemble de son œuvre, dessinent un véritable lexique délissien, sonnant comme une alternative revigorante à la vulgate muséale contemporaine. Plutôt qu’une recension classique, cet abécédaire est ainsi une tentative subjective de dévoiler quelques lieux, flux, agents, voire fantômes du « musée métabolique » de Clementine Deliss. Autant de figures puissantes qui aident à imaginer un rapport à la fois plus créatif et courageux aux collections coloniales et à les réinscrire résolument dans le présent. Près de deux ans après sa publication, ce « Petit Livre rose », qui n’a rien perdu de son actualité, a conservé sa place sur ma table de travail ; à la fois source d’inspiration féconde et aiguillon empêchant de céder à la torpeur muséale.
⁂
Nota : les mots suivis d’un astérisque renvoient à une entrée du glossaire.
Artist : sans nier l’apport des chercheur·se·s, Clementine Deliss attribue un rôle central, sinon premier, aux artistes contemporain·e·s dans la remédiation* des objets, par leur capacité à déloger l’incongru, le non-dit ou le non-vu dans les collections. « Every time I took an artist through the depots, I could be sure that they would identify something unresolved. Out of the corner of their eye, they would spy an object lying on the top of the shelf, locked away and ignored. The presupposition of exoticism was actually alive in the stores of the ethnographic museum. You only needed someone from the outside to activate a search. Later, when we undertook fieldwork in the museum with guest artists and writers, artifacts that had been neglected by custodians for years were seen, touched, and gradually inserted into a critical and experimental process of remediation*. » (p. 30) La trajectoire et le profil des artistes (cinéastes, plasticien·ne·s, écrivain·e·s, etc.) invité·e·s sont variés. Deliss affirme une conception « open-source » des collections, bousculant les questions soulevées par les discussions sur l’appropriation culturelle, dans les limites d’une attitude respectueuse à l’égard des sociétés d’origine. En 2013, elle invite ainsi le duo de designers de mode PAM (Perks and Mini) à s’inspirer des collections textiles du musée et à penser une installation hybride mélangeant leurs créations à des parures de Papouasie-Nouvelle-Guinée, au grand dam de certains conservateur·rice·s. « I replied that this assemblage represented a contemporaneous model of diasporic appropriation and hybridization common among the younger generation today, consciously crossing over ethnicities and cultural identities. » (p. 83) Dans une approche circulaire et organique de la démarche, le produit de ces résidences entre dans les collections du musée, qui abandonne ainsi les achats sur le marché de l’art et les acquisitions tout court au profit du développement de cette nouvelle collection contemporaine pensée en miroir du fonds historique dont elle offre une lecture oblique et non-ethnographique.
Collection-centric : à rebours de la primauté accordée aux expositions temporaires dans le fonctionnement et la cadence des musées contemporains, Clementine Deliss revendique un retour aux objets par une approche intellectuelle, artistique, architecturale entièrement « centrée sur les collections ». Celle-ci se matérialise à travers la cohabitation dans la durée des chercheur·se·s et artistes accueilli·e·s au laboratoire* avec les objets, mais surtout par le choix de se départir des expositions « blockbuster », qui emprisonnent les artefacts dans des scénographies lourdes et didactiques. « The focus on explanation as the lead ideology of so many museological displays holds back the visual dramaturgy of curatorial practice substituting it with a grammatical linearity of formalized knowledge production. […] The textualization of exhibitions replaces the (much criticized) retinal access to artworks and the broader corporeal and phenomenological apprehension of what takes place within the rooms of a museum.” (p. 104).
CT-scan : alors que de nombreux musées européens investissent dans l’imagerie scientifique de leurs collections, Clémentine Deliss insiste sur la violence de ces radiographies, conduites bien souvent unilatéralement, sans l’accord des communautés, et qui participent d’une réactivation de méthodes et modèles hérités de l’anthropologie physique du XIXe siècle. “How far are artists, priests, and healers involved in deciding if such analyses should be performed on their heritage, whose coded knowledge has been enacted for centuries by way of their iconic sculptures? Is this new biomedical research taking place in all European ethnographic museums? The return to physiognomic analyses is a scientific reformulation of anthropology’s problematic past transferred today onto sequestered collections.” (p. 99)
Domestic : il s’agit, là, sans doute, de l’un des mots les plus cruciaux et opérants de l’essai. L’idée d’un musée comme « tiers-lieu » ou « lieu de vie », susceptible d’accueillir d’autres usages du public que la simple délectation passive, est aujourd’hui largement récupérée par les institutions culturelles de tous bords. Cependant, ce changement de discours laisse généralement de côté l’envers du décor, à savoir la physiologie et l’infrastructure matérielle même des musées. Plutôt que de penser un renouvellement du rapport des visiteur·se·s au musée a priori, Clémentine Deliss propose de s’attaquer en priorité aux formes et conditions du travail muséal afin d’agir en profondeur sur les causes de l’impasse des musées d’ethnographie. Comme un écho aux trois villas qui constituent le Weltkulturen Museum, la curatrice entend explorer les potentialités d’un musée-maison. « The new model for the museum would be the house itself, a renewal of a domestic environment of repose and reflection, of living, dialoguing, researching, and production in contrast to a corporate site of consumerist culture.” (p. 17) Ce principe s’incarne tout particulièrement à travers la pratique d’une « recherche domestique » (domestic research), située physiquement et intellectuellement à l’intérieur du musée et prenant les collections*, l’histoire et l’infrastructure du musée, comme appui. Le laboratoire* en constitue la principale matérialisation, conçu comme un lieu de travail pour les résidents, mais aussi de vie, de réflexion, de partage, de césure, au contact des objets. Cette approche domestique se veut aussi un cercle vertueux, une auto-alimentation de l’institution à partir du potentiel de ses vastes collections. La transformation du cadre architectural et matériel du musée d’ethnographie doit se départir de ses normes hygiénistes et permettre un contact plus étroit avec les collections.
Esterhazy, Mathis : à la demande de Clémentine Deliss, le designer viennois développe un mobilier modulaire adapté à l’ensemble des besoins fonctionnels du musée et, en particulier, à la consultation et à l’exposition de ses objets. Outre la volonté de rompre avec « le discours visuel dominant des musées d’ethnographie », cette commande visait à favoriser au maximum la recherche collecto-centrée (collection-centric* labor), sans porter préjudice à la sécurité des objets. « What was needed was a combination of functionality and neutral aesthetics that not only suspended the inevitable anachronism so common to ethnographic displays but actually aided the circulation and analysis of these artifacts rather than their containment. » (p. 60)

Vues du mobilier de Mathis Esterhazy © Weltkulturen Museum, Frankfurt. Photo: Wolfgang Günzel.
Hagen, Bernard : figure refoulée du Weltkulturen Museum, exhumée par Clémentine Deliss des « tréfonds archivistiques » (« archival underbelly ») du musée, Bernard Hagen (1853-1919) fut le fondateur du musée et, avant cela, un médecin travaillant dans une plantation coloniale de tabac à Sumatra dans les années 1890. En parallèle des soins prodigués aux travailleur·se·s victimes des ravages des pesticides, Bernard Hagen participa activement à la classification des races dont la plantation coloniale, avec ses ouvriers originaires de toute l’Asie, offrait un terrain d’observation privilégié. Les archives du Weltkulturen Museum ont livré les nombreux clichés anthropométriques du médecin allemand, dont une cinquantaine de gros plans sur les organes génitaux des personnes photographiées. Plutôt que d’occulter cette sinistre archive, la curatrice en fit l’objet central de séminaires et d’une exposition en 2014, Foreign Exchange (or the stories you wouldn’t tell a stranger), explorant la relation entre l’histoire du musée et celle de la ville de Francfort – hub financier et commercial majeur – et le lien étroit entre la production des savoirs ethnologiques et le commerce colonial. Afin de tenir compte de leur caractère dégradant, les clichés d’organes génitaux furent présentés dans des vitrines hautes, nécessitant une démarche active des visiteur·se·s pour être vus et permettant d’interroger et déranger le rapport voyeuriste à ces images3.

Vue de l’exposition Foreign Exchange (or the stories you wouldn’t tell a stranger) (2014) avec, au fond, les vitrines des photographies de Bernard Hagen © Weltkulturen Museum, Frankfurt. Photo: Wolfgang Günzel.
Laboratory : fine connaisseuse de l’histoire de l’anthropologie française, Clémentine Deliss s’approprie ce terme qui résonne fortement avec l’histoire du musée de l’Homme. Conçu comme un « instrument de travail orienté vers la production, le stockage, et l’élaboration des connaissances4 », le musée-laboratoire imaginé par Paul Rivet dans les années 1930 offre des réminiscences avec le projet de Deliss visant à replacer la recherche, l’enseignement et l’interdisciplinarité au cœur du musée. Néanmoins, à Francfort, il ne s’agit plus de produire un savoir supposé objectif, « scientifique », sur les « Autres », mais d’inviter des artistes* et chercheur·se·s – dans des disciplines aussi variées que le droit, l’écologie, les mathématiques, l’anthropologie ou les études postcoloniales – à penser des « historiographies subjectives écrites autour de collections et d’archives contestées » (p. 105). Au-delà du concept, le laboratoire est aussi un espace très concret du musée, installé dans l’une des trois villas du musée, accueillant à l’étage les chambres et les studios de travail et, au rez-de-chaussée, le laboratoire proprement dit, lieu de consultation des objets, ainsi que les archives photographiques. L’accès jour et nuit aux collections, permis par une relation de confiance avec les résident·e·s, est alors la condition de la production d’une recherche originale et susceptible de repenser l’ancrage de l’institution dans le présent. « The laboratory villa was the intellectual and aesthetic heartbeat of the museum, designed to restore an ergonomic rhythm to the critical apprehension of the institution and the artifacts in its possession. » (p. 56)

Vue du laboratoire (LABOR), 2013 © Weltkulturen Museum, Frankfurt. Photo: Wolfgang Günzel.
Manifesto : encadrant le corps du texte, deux manifestes – « Manifesto for the Post-Ethnographic Museum », « Manifesto for Rights of Access to Colonial Collections Sequestered in Western Europe », ce dernier lu pour la première fois lors de la Biennale de Dakar en mai 2018 –, font figure de précipité du livre dont ils reprennent une partie des mots forts. Ils signent la singularité de la curatrice, adepte de cette forme littéraire, et de sa déambulation poétique et politique dans l’univers des musées d’ethnographie. Par leur ton et leur rythme incisifs, ces courts textes instillent à la fois urgence et émotion dans un débat souvent aride ou tiède sur l’avenir des collections coloniales.
Metabolic : bien qu’elle donne son titre au livre, l’expression de « musée métabolique » n’en est pas pour autant pas un slogan. Celui-ci apparaît au fil des pages, à mesure que se dévoile la physiologie du Weltkulturen Museum proposé par Clémentine Deliss. La métaphore biologique est filée à travers l’ensemble de l’ouvrage pour dénoncer l’atrophie des musées d’ethnographie. « The ethnological museum as a reservoir of energy, an ‘orgone accumulator’ of cultural consumption, still fired by colonial greed, no longer pumps enough energy into the system for it to survive unnoticed. » (p. 102). Dans sa critique, l’autrice pousse l’analogie jusqu’à mettre en regard le trafic d’organes et l’exfiltration des biens culturels vers l’Europe. « Like the organ trade, the necropolitical colonial museum survives off the control and regulation of the nerve centers of agency. It confers toxicity onto ambiguous objects, perversely poisoning the institution’s metabolism and calling out for new systems of healing. » (p. 99) Mais l’expression permet également à la curatrice de décrire la physiologie de son modèle, où l’ensemble des fonctions, des lieux et des acteur·rice·s du musée s’imbriquent de façon organique autour du « cœur intellectuel et esthétique » que constitue le laboratoire*. « No longer should anything be seen in isolation, but each inquiry becomes a reflection of temporary interdependencies between artworks, people, objects, media, equipment, experiences, observations, laws, economies, and affects. Be they obliquely related or even incongruous, such alliances can be pertinent enough to initiate new relations between forms of art and emergent meanings, challenging the monopolies of the museum and university to produce and control new diasporic imaginaries. » (p. 112-113)
Necropolital museum : tout au long de sa critique du musée d’ethnographie, Clémentine Deliss file la métaphore de la mort. Elle insiste à la fois sur la façon dont le musée dévitalise voire intoxique les objets qu’il conserve, mais aussi sur la manière dont la crainte de la souillure matérielle et organique (la chasse à la poussière, aux infestations d’insectes ou de moisissures) et symbolique (les lourds souvenirs coloniaux qui poissent les objets) sourd à travers tout son métabolisme* au point de précipiter sa propre mort. « Today, the museum – now hygienist – is obsessed with its own dirty data, cleansing and disinfecting its contaminated past, particularly the bloody residue attached to the traumatic memories of slavery, colonialism, and the holocaust embodies in its collections with their absent proof of legitimate provenance. » (p. 15)
Remediation : ce concept, emprunté à l’anthropologue américain Paul Rabinow (1944-2021), est au cœur du projet de transformation porté par Clémentine Deliss visant à « suspendre le logos de l’ethnos », à sortir les objets des classifications et des interprétations ethnographiques habituels et à leur permettre de déployer d’autres histoires en les réactivant, dans d’autres lieux, au contact d’artistes*, de penseurs ou d’étudiants, issus ou non des communautés d’origine. “Remediation is not about reappropriating colonial spoils safeguarded in obsolete imperial institutions. It is a process of self-reflexive and critical assessment that necessitates careful and respectful interaction with different agents willing to renegotiate the authority of the host.” (p. 111)
-
Clémentine Deliss (dir.), Object Atlas: Fieldwork in the Museum, Bielefeld, Kerber, 2012 ; Clémentine Deliss and Frédéric Keck, « Occupy collections !* Clémentine Deliss in conversation with Frédéric Keck on access, circulation, and interdisciplinary experimentation, on the urgency of remediating ethnographic collections (before it is really too late) », South as a State of Mind, n. 7, Documenta 14, printemps-automne 2016 [en ligne] ; Clémentine Deliss, « Formes rapides de restitution », Multitudes, 2020, n° 78, pp. 185-189 [en ligne]. ↩
-
Afin de ne pas perdre le rythme et l’inventivité de l’écriture de Clémentine Deliss, les citations sont conservées en anglais. ↩
-
Je remercie Lotte Arndt pour cette information. ↩
-
Benoît de L’Estoile, Le Goût des Autres. De l’Exposition coloniale aux Arts premiers, Paris, Flammarion, 2007, p. 104. ↩